Voici la 36e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du quatrième livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.
L’extrait choisi est celui de l’article de M. le professeur Gilles CANDAR consacré à la République sociale & Jaurès et publié dans l’ouvrage Jean Jaurès & le(s) Droit(s).

Volume IV :
Jean Jaurès
& le(s) droit(s)
Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina, Clothilde Combes
Delphine Espagno-Abadie & Julia Schmitz
– Nombre de pages : 232
– Sortie : mars 2020
– Prix : 33 €
– ISBN / EAN : 979-10-92684-44-5
/ 9791092684445
– ISSN : 2272-2963
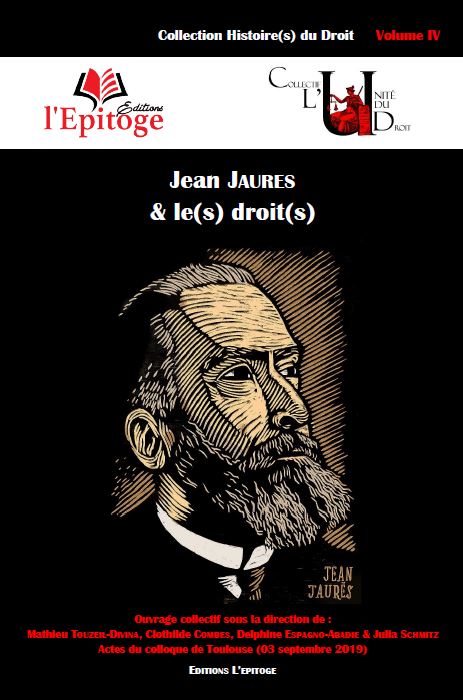
Jaurès
& la République sociale
Gilles Candar
Professeur de chaire supérieure honoraire en histoire,
Président de la Société d’études jaurésiennes
A l’origine, pour Jean Jaurès, jeune Français de son temps, il faut sans doute évoquer la patrie. Il éprouve à son égard comme une première passion. La patrie structure ses premières affections, la raison de ses combats initiaux, le but de sa vie et elle conduit ses premières réflexions. Plus que des paysages et des souvenirs historiques ou littéraires, elle est d’abord pour lui une affaire humaine. Elle s’incarne dans la nation française que le jeune homme ne sépare pas de ses constituants. Elle reste une instance déterminante de sa réflexion, même si celle-ci s’élargit progressivement et s’ouvre à d’autres exigences, qui s’intègrent et enrichissent le noyau initial sans jamais le supprimer. Il faut prendre en considération les conditions de sa formation, de son éveil à la vie civique. Jaurès a onze ans au moment de « l’année terrible[1] », des drames de la guerre malheureuse et de l’amputation des départements d’Alsace-Lorraine. Sa famille compte de nombreux militaires, de tous grades, de l’oncle simple sergent chez les Zouaves au prestigieux cousin de son père, l’amiral Benjamin Jaurès, qui combattit comme général d’infanterie les Prussiens lors de la funeste bataille du Mans. Les civils parents et alliés ressentent tout aussi douloureusement les tristes événements de la période. Le frère de Jean, Louis, devient à son tour marin puis amiral. Jean se tourne vers des études littéraires, mais il souhaite d’abord servir son pays, la communauté nationale à laquelle il appartient. Cette communauté doit s’organiser, vivre et s’unifier. Et pour cela le jeune homme pense très vite que la forme la plus appropriée est la République. Nom d’un régime nouveau, encore assez rare dans le monde d’alors, à l’exception du continent américain, la République est plus fondamentalement un idéal auquel adhère le collégien de Castres et qu’il souhaite faire triompher. Le jeune Jaurès se rattache aux grands souvenirs des Lumières et de la Révolution française. La notion clef de son idéal, qu’il applique aux institutions comme à la démocratie et à la laïcité, est l’égalité, l’égalité des droits et leur universalité. Et comme il veut agir pour cette idée, servir et aider la République, convaincre les tièdes et les indécis et même les adversaires de bonne foi, il se dirige tôt vers l’action publique. On connaît la formule expéditive de la figure tutélaire de sa famille, l’amiral Jaurès, pour faire accepter ce choix à la mère inquiète de Jaurès : « Jean va à la politique comme le canard va à l’eau[2]». Nous pourrions citer aussi Jules Guesde, mi-amusé, mi-admiratif, qui observait un jour que chez Jaurès « l’acte suit toujours la pensée[3] ». Jean se passionne pour les élections, il souhaite être candidat et élu et il réussit assez vite à l’être puisqu’il se retrouve en 1885 à tout juste 26 ans le benjamin de la nouvelle Chambre des députés de la République française. Jaurès est républicain parce que cela lui semble le meilleur moyen, le seul praticable en fait, d’unir les Français, de constituer la nation divisée jusqu’alors par les luttes de partis comme par les divisions sociales, les jalousies et les ressentiments. Cette volonté d’union est le principal ressort de son adhésion à la République tout comme elle sera bientôt celui de son socialisme.
I. La République
Longtemps Jaurès se définit simplement comme républicain, évitant d’ajouter une quelconque étiquette partisane. Il ne se veut ni « opportuniste », ni « radical », pour citer les noms des deux grandes familles politiques républicaines au cours des trois dernières décennies du siècle. A l’instar de Saint-Just, il refuse d’être l’homme d’une « faction », et quand il se convaincra que se revendiquer républicain ne suffit pas, il complètera ou plutôt élargira comme il aime à dire son appartenance politique, mais il ne cessera nullement de s’en réclamer. Le fait est connu et il n’est pas utile d’insister : dès 1893, et jusqu’en 1914, il se présente aux élections comme candidat « républicain socialiste », non plus candidat « républicain » simplement, mais pas non plus candidat « socialiste » tout court. C’est au nom de la République qu’il poursuit son combat, qu’il réclame la justice. Et c’est donc pour instituer véritablement une république où à la différence des cités antiques, tous les hommes adultes seraient des citoyens libres, qu’il se convainc de la nécessité ultime de la socialisation de la production. Jaurès prolonge l’œuvre des grands révolutionnaires de 1789 en l’adaptant et la vivifiant, il ne la récuse pas et toute sa vie il l’assumera, ne serait-ce qu’en approfondissant sa pensée et explorant ses connaissances sur le sujet avec la direction de l’Histoire socialiste (1789-1900) pour laquelle il travaille et rédige les chapitres consacrés aux premières années de la Révolution. C’est ainsi qu’il se plaît à se référer au grand libéral défenseur de la monarchie constitutionnelle Royer-Collard, qui ne pensait pas nécessaire d’ajouter autre chose que « l’égalité des droits » pour définir la laïcité ou la démocratie[4]. Et lorsqu’il envisage la question sociale, Jaurès se place sans hésitation à la suite de Boissy d’Anglas qui estimait la propriété nécessaire à l’exercice des droits civiques. La forme moderne de la diffusion et de l’extension de la propriété lui paraît être celle de la socialisation, qui seule assure à chacun de recevoir sa juste part de propriétaire de la production nationale. Alain Boscus, qui l’a montré dans ses travaux, notamment dans l’édition de deux volumes des Œuvres de Jaurès : Le militant ouvrier et Le socialisme en débat (1893-1897) ainsi que dans diverses communications, contributions et conférences[5]. La propriété, pour Jaurès, est bien un fait social, non un fait naturel, et la société peut donc en contrôler l’étendue et la portée. Très tôt, le futur historien de la Révolution a rappelé ce principe fondamental voté par la Convention dans la constitution de 1793 : « Le droit de propriété ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables[6] ».
De nombreux hommes politiques aiment à citer une phrase de Jaurès qui se retrouve aisément sur internet, et qui en plus provient de La Dépêche de Toulouse, ce qui ne gâte rien : « Je n’ai jamais séparé la République des idées de justice sociale, sans lesquelles elle n’est qu’un mot[7] ». Belle phrase, authentique et en général correctement citée, ce qui n’est pas le cas de toutes les citations de Jaurès qui circulent, mais dont il faut bien exploiter toutes les potentialités. Sa forme modérée convient aux politiques soucieux de rassemblement. Cela vient d’ailleurs de ce qu’elle date de la période où le nouveau collaborateur de la jeune Dépêche n’est pas encore explicitement devenu socialiste, où il est un député républicain du Tarn, aux idées sociales avancées, partisan convaincu d’un réformisme républicain, mais pas encore théoricien ou héraut d’un idéal révolutionnaire.
De toute façon, d’abord et toujours la République. Cet ancrage républicain du socialisme n’a pas commencé avec Jaurès, mais que ce soit dans les congrès de l’Internationale ou au cours de ses voyages ou rencontres, Jaurès le parachève, le justifie, le révèle aux socialistes comme aux autres, alliés potentiels ou adversaires irréductibles, à la nation française et au monde. Jaurès lui donne toute sa force et le situe au cœur du socialisme. Plus que d’autres, à vrai dire beaucoup plus que tous les autres, « le socialisme français est un socialisme républicain » martelait le grand historien Ernest Labrousse, lui aussi originaire d’un Midi déjà presque occitan. Il précisait : « Républicain dans ses origines, dans ses réflexes, dans ses attitudes historiques, dans son implantation territoriale. Républicain au plus lointain et au plus profond de lui-même, au plus profond de son histoire et de sa géographie politique[8] ».
C’est un fil que nous retrouvons constamment. Nous pouvons même considérer que c’est la raison profonde de l’axe majoritaire qui se constitue dans le socialisme français autour de Jaurès et de Vaillant, parfois flanqués des allemanistes toujours un peu frondeurs. Des aléas, circonstances ou brouilles, peuvent compliquer les choses, mais comme aimait à dire le fondateur de L’Humanité, il faut aller à l’essentiel : « au pays de la Grande Révolution, poursuivie et continuée dans les révolutions du XIXe siècle », le socialisme ne peut être qu’un socialisme républicain. C’est sans doute une orientation toujours peu ou prou contestée : les marxistes orthodoxes ou pouvant se revendiquer comme tels avec Lafargue[9] et Guesde[10], le premier plus doctrinaire et le second plus propagandiste et homme d’action, les « insurrectionnels » qui suivent Gustave Hervé[11], certains syndicalistes révolutionnaires ou des anarchistes critiquent, condamnent à l’occasion ce sur-moi républicain dont ils voient les dangers d’évolutions, d’adaptations et d’alliances… Eux-mêmes sont le plus souvent amenés à composer, à s’adapter et comme cela arrive parfois à s’immerger à leur tour dans un bain républicain d’autant plus réconfortant et apprécié qu’il a été auparavant nié ou dédaigné. C’est évidemment ce qui relie et donne son sens aux grands choix du socialisme français de la période, et notamment dans l’affaire Dreyfus qui montre la revendication de justice comme structurant le socialisme autant que la position de classe dans les rapports de production.
Etre républicain ne signifie nullement se contenter de la légalité républicaine ou des institutions de 1875 acceptées à contrecœur par la gauche républicaine, radicale ou socialiste. La République n’a pas été instaurée par les seuls républicains et cela pèse longtemps sur l’attitude des socialistes. Ce n’est que progressivement qu’ils acceptent le principe de la participation aux élections sénatoriales ou à celle du président de la République dont le rôle d’incarnation et d’arbitre n’est pas automatiquement admis[12]. Une fois le principe accepté, les socialistes se contentent longtemps de peser en faveur d’un président le plus républicain possible, c’est-à-dire attaché aux libertés publiques et aux droits des parlementaires.
Tentés par le monocaméralisme héritier de la Révolution française, les socialistes acceptent le principe d’une deuxième Chambre, mais veulent profondément la transformer. Le choix de Jaurès l’oriente vers une Chambre du Travail représentant les catégories socio-professionnelles[13]. Si la République démocratique apparaît aux socialistes comme la forme politique nécessaire d’une France socialiste, celle-ci ne saurait se résumer à un régime parlementaire trop distancié de la volonté populaire. La population civique, qui devrait englober les femmes puisque le principe en a été adopté à « l’immortel congrès » de Marseille en 1879, doit pouvoir s’exprimer par des pétitions ou d’autres modalités. Les socialistes sont à l’origine de la reconnaissance de facto du droit de manifester au début du XXe siècle, sur le modèle britannique que Vaillant par exemple avait pu observer de près lors de son exil des années 1870. Leur soutien à la procédure du référendum a été oublié au fur et à mesure que s’est accentué le parlementarisme de la Sfio. Mais la revendication du référendum se retrouve dans des familles socialistes différentes, chez les anciens blanquistes comme chez les possibilistes[14] de Brousse et d’Allemane[15]. Le parti lui-même le réclame pour sortir du conflit entre la Chambre et le Sénat sur l’instauration de la représentation proportionnelle, adopté par la Chambre en 1912, mais refusé par la Chambre haute l’année suivante.
D’une manière générale, les réflexions de Jaurès et des socialistes tendent à sortir le régime parlementaire de l’entre-soi bourgeois de sa tradition orléaniste et de lui permettre de prendre en compte, d’être animé ou confronté à une participation civique et populaire. Cela doit évidemment être organisé, formalisé. Cela passe au minimum par de nombreux comptes rendus de mandat, par l’organisation des citoyens en partis structurés et liés à leurs mandants, par l’instauration d’un mode de scrutin proportionnel qui n’est pas seulement, du moins chez Jaurès, l’instauration d’une technique ou la possibilité d’un avantage électoral, mais qui renvoie à une philosophie de l’action politique et de la démocratie, qui se veut aussi une garantie du passage pacifique et ordonné d’une société bourgeoise et capitaliste au socialisme.
II. La Sociale
Nous ne nous sommes éloignés qu’en apparence du concept de République sociale. Il fallait d’abord montrer que l’adjectif va tellement de soi pour Jaurès qu’il est quasiment superfétatoire. Comme il le disait à son interlocuteur syndicaliste en 1887, c’est bien la République en elle-même qui porte une exigence de justice sociale, seul soubassement possible au suffrage universel. C’est ce que Jaurès explique notamment dans un de ses plus célèbres discours, avec d’autres mots et dans un autre contexte, puisqu’il est alors à la Chambre le véhément porte-parole du groupe socialiste face à un gouvernement très hostile. Dans son discours du 21 novembre 1893[16], Jaurès combat la politique répressive du gouvernement Dupuy et contribue fortement à le faire tomber, mais plus profondément, il explique aussi le lien entre République, l’action naissante du mouvement ouvrier et ses buts ultimes : « Dans l’ordre politique, la nation est souveraine et elle a brisé toutes les oligarchies du passé ; dans l’ordre économique la nation est soumise à beaucoup de ces oligarchies […] par le suffrage universel, par la souveraineté nationale, qui trouve son expression définitive et logique dans la République, vous avez fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de rois […] mais au moment même où le salarié est souverain dans l’ordre politique, il est dans l’ordre économique réduit à une sorte de servage.[…] Et c’est parce que le socialisme apparaît comme seul capable de résoudre cette contradiction fondamentale de la société présente, c’est parce que le socialisme proclame que la République politique doit aboutir à la République sociale, c’est parce qu’il veut que la République soit affirmée dans l’atelier comme le est affirmée ici ; c’est parce qu’il veut que la nation soit souveraine dans l’ordre économique pour briser les privilèges du capitalisme oisif, comme elle est souveraine dans l’ordre politique, c’est pour cela que le socialisme sort du mouvement républicain. C’est la République qui est le grand excitateur, c’est la République qui est le grand meneur[17]… ».
La République sociale se tient aux deux bouts de la chaîne chez Jaurès. Elle est à la fois l’objectif concret, immédiat, des luttes politiques et sociales et le symbole de l’Idéal poursuivi. Pour suivre ce mouvement, il suffirait au reste de reprendre la belle anthologie commentée réalisé par Vincent Duclert aux éditions Privat, à Toulouse, en 2014 et qui porte ce simple titre : Jaurès. La République. Nous pouvons aussi à nouveau contextualiser un moment et renvoyer aux premières années de vie publique pour Jaurès. La République qui triomphe à la fin des années 1870 et au début des années 1880 est une République sage, conservatrice, rassurante pour les possédants. C’est ce qu’ont voulu ses promoteurs, Thiers, Gambetta ou Ferry, c’est ce qu’exprime la longue présence au ministère des Finances du banquier et théoricien libéral Léon Say, quelle que soit la couleur plus ou moins conservatrice ou républicaine du ministère dans la phase d’affrontements et de transition des années 1870, de Thiers à Waddington, en passant par Dufaure, Buffet ou Jules Simon[18]. La France est un pays encore en nette majorité rurale, avec un artisanat nombreux, une industrie économiquement décisive mais qui socialement ne concerne encore qu’une population assez réduite. L’impôt est doux et l’ambition sociale réduite même chez Gambetta à une série de « besoins multiples et variés correspondant à des remèdes variés et multiples » (Le Havre, 18 avril 1872). Ces besoins sont en tout cas l’objet d’intenses batailles au Parlement ou dans la société, avec cette période caractérisée par l’historienne Michelle Perrot comme celle de la Jeunesse de la grève[19]. Il s’agit d’obtenir les garanties élémentaires qui donneraient un début de caractère social à la République, la limitation de la durée du travail par exemple, côté syndical c’est la célébrissime revendication des 8 heures portée par la journée du 1er mai et l’action de l’Internationale, côté parlementaire c’est la mise en place progressive de la journée de dix heures, instaurée par le premier socialiste ministre de la IIIe République, Alexandre Millerand, dans des conditions difficiles car la semaine de soixante heures ainsi induite fait selon ses détracteurs peser des risques sur l’industrie française et empêche le travailleur de travailler librement pour gagner plus, c’est aussi l’instauration d’une journée hebdomadaire de repos obligatoire, votée en 1906 grâce au renfort de nombreux réformateurs sociaux y compris des catholiques partisans du dimanche férié, ce sont les premières lois d’hygiène et d’assistance sociale, sur lesquelles interviennent davantage Vaillant et les députés de Paris, l’instauration elle aussi difficile et contestée des premières retraites ouvrières et paysannes décidées en 1910, le rassemblement à la fin de la même année de la législation sociale dans un Code du Travail voulu par Arthur Groussier et son collègue Vaillant. Nous ne citons que les principales mesures qui à vrai dire nous apparaissent comme des linéaments modestes comparées aux grands apports du Front Populaire ou de la Libération, mais qui en sont les prémisses et dont les perspectives globales sont d’ores et déjà pensées à ce moment-là, et qui constituent le noyau initial de la proclamation de la France comme « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » par la Constitution de 1946, reprise par celle de 1958, ce qui soixante-dix ans plus tard est toujours la question centrale du débat politique et sociale de notre pays.
III. La République sociale, une création continue
Le temps passe en effet. Clemenceau s’est un jour moqué de Jaurès, prétendant qu’on reconnaissait ses discours à ce que les verbes y étaient toujours conjugués au futur[20]. Le persiflage comporte une part de vérité car Jaurès refuse le pragmatisme une politique enfermée dans la gestion à courte vue et un présent dépourvu d’imagination. Il demande une orientation générale et nettement pensée, continuant ainsi longtemps à préférer la politique même bourgeoise de Ferry à la critique trop négative de Clemenceau. Il apprécie les grands réformateurs, du présent comme du passé, au service d’une idée. Tout au long de son célèbre chapitre X de L’Armée nouvelle (1910), il affirme le primat de l’idéal sur les contraintes matérielles, de la morale sur les rapports de forces, de la volonté politique sur les dogmes de fatalité. Jaurès est en accord avec le marxisme sur l’explication du mécanisme de l’exploitation capitaliste. Pour lui, le travail est le seul véritable dieu de l’histoire et il doit l’emporter dans sa compétition sur le Capital. Le prolétariat doit apprendre, s’éduquer, se discipliner, s’organiser, combattre l’alcoolisme et tous les fléaux qui l’affaiblissent ou le détournent de son œuvre d’émancipation. La lutte des classes doit se poursuivre dans un cadre républicain et pacifié. Il existe un terrain commun, celui de l’humanité, à condition que la paix et la démocratie soient maintenues. La démocratie est une force modératrice : « la bourgeoisie est obligée à des concessions opportunes et le prolétariat est détourné des révoltes furieuses et vaines ».
Jaurès dépasse les distinctions entre réformiste et révolutionnaire en préconisant « l’évolution révolutionnaire[21] » selon une formule empruntée à Marx. Jaurès définit très précisément celle-ci dans sa série de grands articles regroupés en Etudes socialistes : selon lui, l’évolution révolutionnaire consiste à « introduire dans la société d’aujourd’hui des formes de propriété qui la démentent et qui la dépassent, qui annoncent et préparent la société nouvelle, et par leur force organique hâtent la dissolution du monde ancien. Les réformes ne sont pas seulement, à mes yeux, des adoucissants : elles sont, elles doivent être des préparations. Ainsi, sous l’action socialiste, elles prennent un caractère et une efficacité révolutionnaire[22] ». Le but final de la politique socialiste est bien toujours révolutionnaire puisqu’il s’agit de « constituer l’humanité » avec une société fondée sur la socialisation des moyens de production. Mais pour l’atteindre, et sans exclure les accidents de l’histoire, Jaurès envisage de plus en plus ouvertement une succession de réformes, ce que Charles Fourier appelait un engrenage de réformes, qui pouvait comprendre des moments d’accélération et de rupture, d’autres plus calmes et lents. Il dégage un chemin étroit où la lutte des classes la plus intense se concilie avec la démocratie, l’unité de la patrie et la cohésion et la continuité de la vie sociale. Elle aboutit en effet à un régime d’assurance sociale, à des contrats collectifs, à des conditions de vie et à une participation des travailleurs à la puissance économique qui sont à la fois un stade développé du capitalisme – Jaurès utilise à ce propos l’expression de « phase hypercapitaliste » et la porte ouverte par étapes « à la socialisation intégrale ». Peu importe dans ces conditions de savoir s’il faut privilégier en démocratie le vocabulaire révolutionnaire, puisque « la révolution sociale prend nécessairement la forme de l’évolution », ou réformiste, puisque « l’évolution a nécessairement une valeur révolutionnaire » explique-t-il dans L’Armée nouvelle[23]. Cette fameuse synthèse a pu parfois sembler trop habile ou insuffisamment étayée en doctrine. Elle s’appuie en tout cas sur un solide sens historique, sur une capacité à retrouver de la cohérence dans les phases d’avancée brusque comme de calme apparent, voire de régression qui caractérisent l’histoire contemporaine et c’est sans doute cette ductabilité et cette compatibilité avec le mouvement historique éprouvé à son époque et depuis qui expliquent la persistance et la résilience de la pensée jaurésienne comme axe structurant la gauche française dans ses profondeurs.
La République sociale est à la fois l’horizon de la lutte quotidienne et celui de l’avenir. Il n’y aurait pas grand sens à les distinguer trop abruptement puisque les deux s’enchaînent et s’entremêlent sans forcément se figer dans des formules stables. Et pour autant, contrairement à Bernstein, ou plutôt à l’interprétation courante et erronée du théoricien allemand, reposant sur des formulations décalées ou mal comprises[24], l’action ne se réduit pas au mouvement, mais doit conserver la spécificité de son but. Un idéalisme moral exigeant préside à cette analyse sociale et politique de la lutte des classes. La République sociale n’est pas tenue quitte d’être nécessaire ou plus juste, elle doit permettre un progrès de l’humanité. Le socialisme, écrit-il dans L’Armée nouvelle, doit démontrer « qu’il est capable d’assurer une production puissante, et, dans l’harmonie de l’action sociale, le jeu libre et fort des énergies individuelles ». L’idée forte qu’il développe tout au long du célèbre chapitre X de ce livre (« Le ressort moral et social. L’armée, la patrie et le prolétariat ») est le primat de l’idéal sur les contraintes matérielles, de la morale sur les rapports de forces, de la volonté politique sur les dogmes de fatalité . Il ne récuse pas les seconds termes de chacune de ces alternatives, mais il plaide pour leur juste évaluation. Ce qu’il veut, c’est en somme, écrit-il dans sa Préface aux discours parlementaires[25], d’organiser l’humanité sans Dieu, ni roi, ni patron, c’est-à-dire d’aller jusqu’au bout du programme de la Révolution française, qui n’est pas fondamentalement violence ou bouleversement pour le principe, mais construction du maximum de liberté, d’égalité et de fraternité pour les humains. « L’humanité n’existe point encore ou elle existe à peine », écrit-il dans son premier éditorial de L’Humanité[26]. C’est à la réalisation de celle-ci que la politique doit se consacrer, qu’il s’agisse de l’élaboration de la loi au Parlement, de la gestion des collectivités locales, des luttes sociales ou de l’œuvre de propagande et d’organisation de l’opinion, du moindre détail de l’action publique aux grandes secousses.
[1] Hugo Victor, L’année terrible, Paris, Michel Lévy frères, 1872.
[2] Le mot se retrouve chez tous les biographes de Jaurès. Le premier à l’avoir relaté est sans doute son ami et camarade d’Ecole, Lucien Lévy-Bruhl, dans son article nécrologique pour l’Annuaire de l’Ecole Normale Supérieure, repris ensuite en volume aux éditions de L’Humanité, 1916, puis sous le titre Jean Jaurès. Esquisse biographique, Paris, Rieder, 1924.
[3] Cité par Jaurès au moins deux fois, dans sa conférence sur Bernstein et l’évolution de la méthode socialiste, Paris, salle des Sociétés savantes, 16 février 1900, et dans sa controverse avec Jules Guesde à l’hippodrome de Lille, le 26 novembre 1900, toutes deux repris dans Défense républicaine et participation ministérielle 1899-1902, tome 8 des Œuvres de Jean Jaurès, édition établie par Agulhon Maurice et Chanet Jean-François, Paris, Fayard, 2013, p. 265 et 346.
[4] Discours du 22 janvier 1822, cité par Jaurès dans son discours sur l’enseignement laïque du 30 janvier 1904, voir son édition par Lalouette Jacqueline dans Laïcité et unité, tome 10 des Œuvres de Jean Jaurès, Paris, Fayard, 2015, p. 82.
[5] Boscus Alain, « Jaurès et les nationalisations », colloque de Castres sur Jaurès et l’Etat, Cahiers Jaurès n°150, octobre-décembre 1998 et « Conception jaurésienne de la propriété sociale », site de la SEJ www.jaures.info.
[6] Jaurès Jean, « Le socialisme de la Révolution française », La Dépêche, 22 octobre 1890, repris par Ducange Jean-Numa, Socialisme & Révolution française, Paris, Démopolis, 2010 ; Duclert Vincent, Jaurès. La République, Toulouse, Privat, 2014 et dans Le passage au socialisme, tome 2 des Œuvres de Jean Jaurès, édition par Rebérioux Madeleine et Candar Gilles, Paris, Fayard, 2011.
[7] Jaurès Jean, « Lettre à Jacques Balfet, président de la chambre syndicale de la laine et du bâtiment à Mazamet », La Dépêche, 24 octobre 1887.
[8] Labrousse Ernest, « Le socialisme et la Révolution française », préface à Jaurès Jean, Histoire socialiste de la Révolution française, éd. Soboul Albert, Paris, Editions sociales, 1968, rééd. 2014.
[9] Pour une approche globale, synthétique et scientifique, Lafargue Paul, Paresse et révolution. Ecrits 1880-1911, édité par Candar Gilles et Ducange Jean-Numa, Paris, Tallandier, « Texto », 2009.
[10] Ducange Jean-Numa, Jules Guesde, l’anti-Jaurès ?, Paris, Armand Colin, « Nouvelles biographies », 2017.
[11] Heuré Gilles, Gustave Hervé. Itinéraire d’un provocateur, Paris, La Découverte, « L’espace de l’histoire », 1997.
[12] Conord Fabien, Les socialistes et les élections sénatoriales (1875-2015), Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2015 et Les élections sénatoriales en France 1875-2015, Rennes, Pur, 2016 ; Candar Gilles, Quel président de la République ? Les choix de Jaurès, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2016.
[13] Chatriot Alain, « Jaurès face au Sénat. La Chambre haute : problème ou solution pour les socialistes et les républicains », Cahiers Jaurès, n°174, octobre-décembre 2004.
[14] Candar Gilles, Edouard Vaillant. L’invention de la gauche, Paris, Armand Colin, 2018.
[15] Jousse Emmanuel, Les hommes révoltés. Les origines intellectuelles du réformisme en France (1871-1917), Paris, Fayard, 2017.
[16] Un des plus grands classiques de la pensée jaurésienne, souvent édité et réédité. Il est repris dans le tome 4 des Œuvres de Jean Jaurès, Le militant ouvrier, édition par Boscus Alain, Paris, Fayard, 2017, p. 454-466.
[17] Dans l’édition Fayard des Œuvres, p. 460-461,
[18] Garrigues Jean, Léon Say et le centre gauche (1871-1896), la grande bourgeoisie libérale dans les débuts de la Troisième République, thèse d’histoire soutenue à l’université de Paris-X sous la direction du professeur Philippe Vigier, 1993.
[19] Une grande thèse, un livre devenu classique et une réédition pour la postérité : Perrot Michelle, Les ouvriers en grève. France 1871-1890, Paris-La Haye, Mouton, 1973, 2 tomes ; Jeunesse de la grève : France, 1871-1890, Paris, Le Seuil, « L’univers historique », 1984 et Les chemins des femmes, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 2019.
[20] Appréciation répétée partout sans qu’elle puisse être sourcée avec précision mais conforme à ce qu’exprime Clemenceau dans sa grande polémique de juin 1906 contre Jaurès lors des grèves consécutives à la catastrophe de la compagnie des mines de Courrières (1100 morts environ), cf. Candar Gilles et Valls Manuel, La gauche et le pouvoir. Juin 1906 : le débat Jaurès-Clemenceau, Paris, Fondation Jean-Jaurès, 2010 et pour la partie jaurésienne de la controverse Voici le XXe siècle ! tome 11 des Œuvres de Jean Jaurès, édition par Duclert Vincent, Paris, Fayard, 2019.
[21] Jaurès Jean, « République et socialisme », La Petite République, 17 octobre 1901.
[22] Ibidem. Les Etudes socialistes maintes fois rééditées l’ont été récemment par Chanet Jean-François et Agulhon Maurice dans Défense républicaine et participation ministérielle, op. cit. Leur interprétation est discutée par Scot Jean-Paul, Jaurès et le réformisme révolutionnaire, Paris, Stock, 2014.
[23] Jaurès Jean, L’Armée nouvelle (1910), rééditée en 1915, 1932, 1969, 1977, 1992 et dans le tome 13 des Œuvres de Jean Jaurès, édition par Becker Jean-Jacques, Paris, Fayard, 2012.
[24] Vaste débat engagé depuis en France depuis au moins la parution chez Stock en 1900 de la traduction française de son ouvrage, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, souvent accessible aujourd’hui sous le titre Les présupposés du socialisme, Paris, Seuil, 1974. Voir la conférence de Jaurès déjà évoquée et les travaux d’Emmanuel Jousse sur la question, notamment Réviser le marxisme ? D’Eduard Bernstein à Albert Thomas, Paris, L’Harmattan, 2007 et « Jean Jaurès et le révisionnisme de Bernstein : logiques d’une méprise », Cahiers Jaurès n°192, avril-juin 2009.
[25] Jaurès Jean, « Le socialisme et le radicalisme en 1885. Préface aux Discours parlementaires », 1904, repris dans Bloc des gauches, tome 9 des Œuvres de Jean Jaurès, édition par Candar Gilles, Duclert Vincent et Fabre Rémi, Paris, Fayard, 2016, p. 66 et s.
[26] Jaurès Jean, « Notre but », L’Humanité, 18 avril 1904, repris dans Bloc des gauches, op. cit., p. 403-406.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).
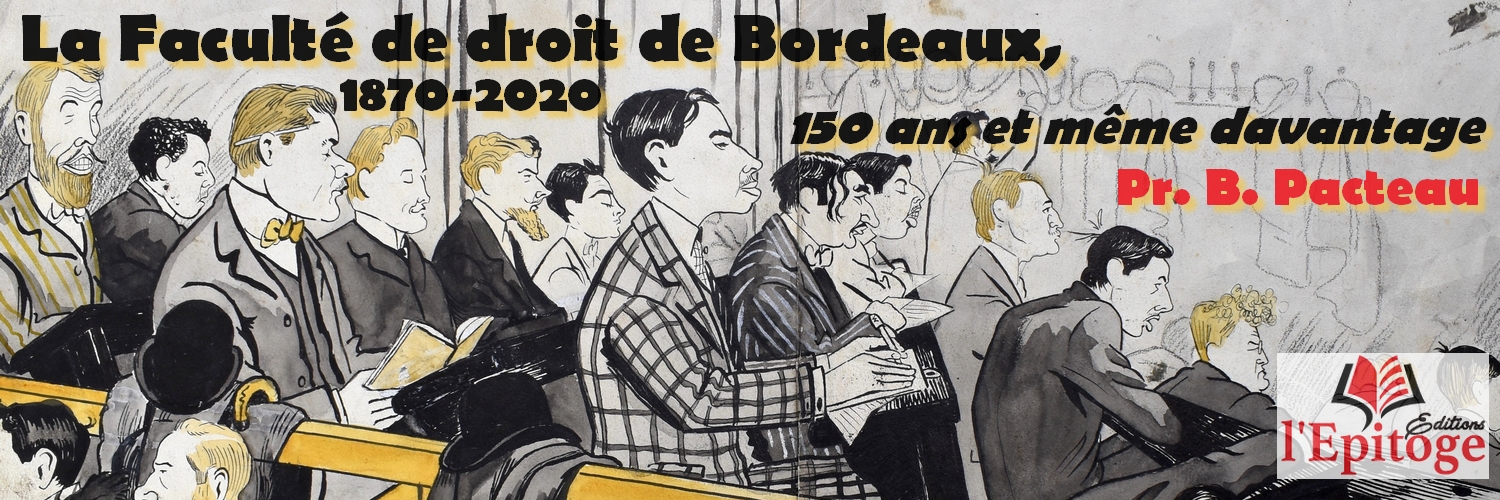
À propos de l’auteur