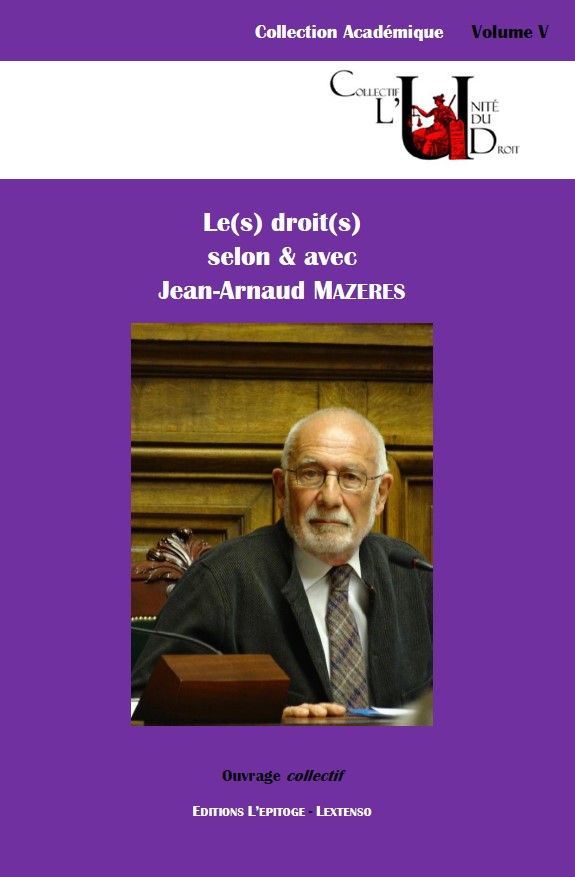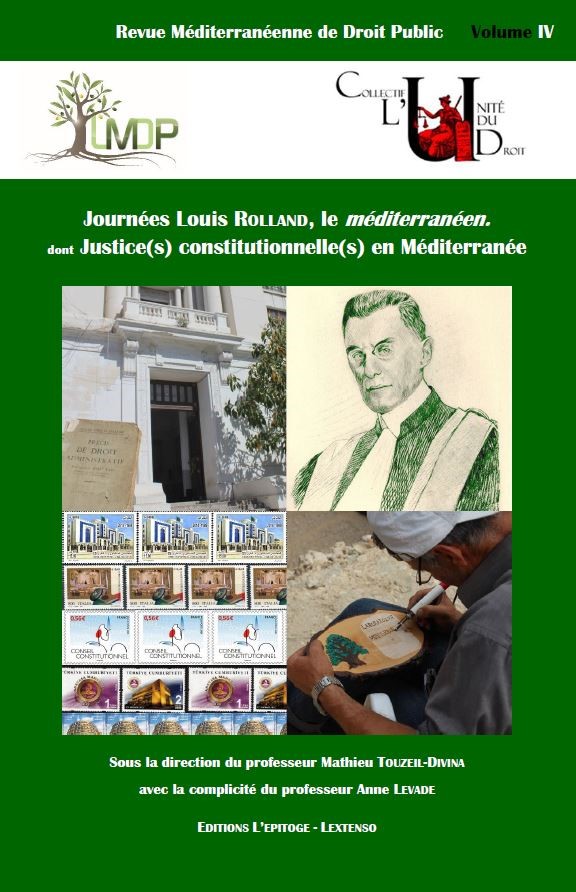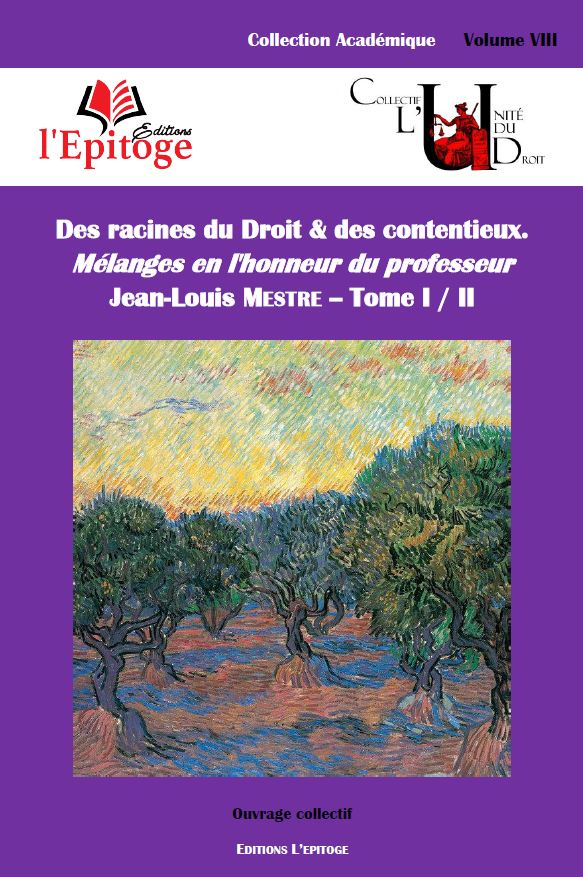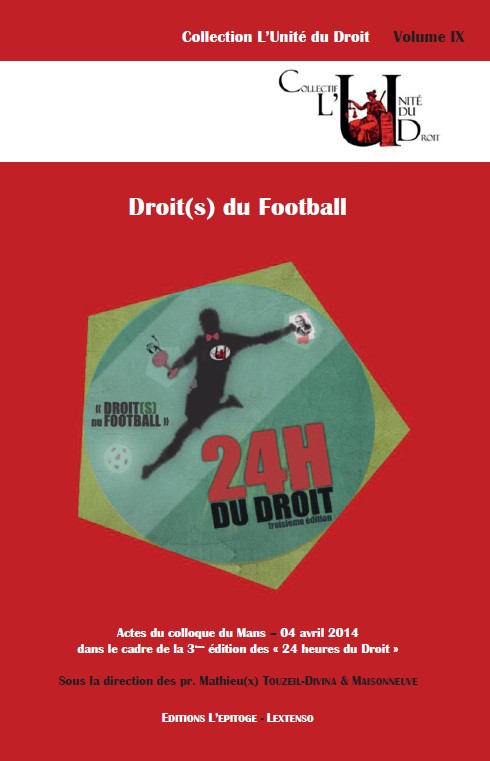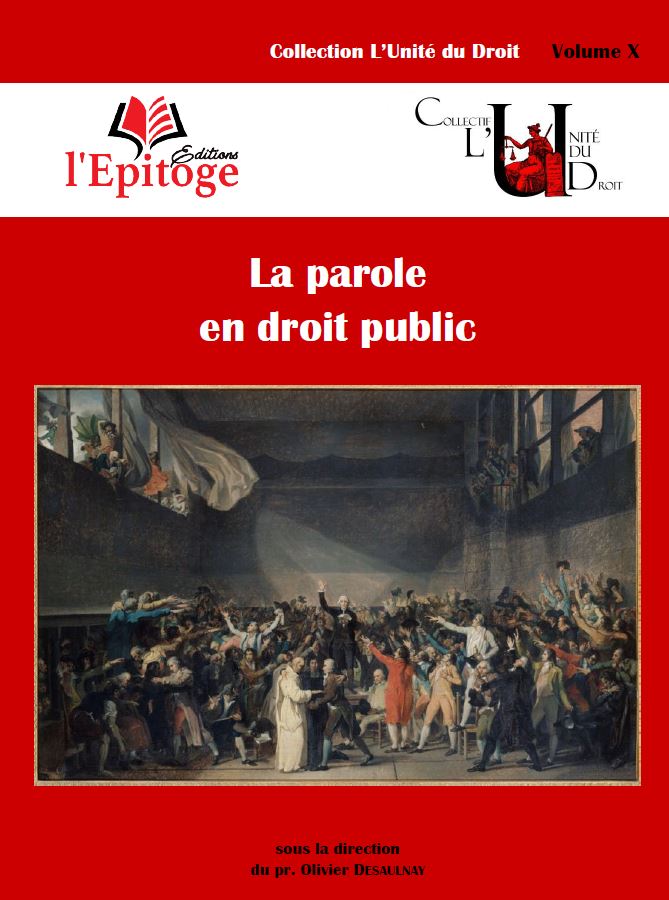Voici la 21e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 33e (et futur) livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.
Cet ouvrage forme le trente-troisième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».
Volume XXXIII :
Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit
Ouvrage collectif sous la direction de
Mélanie Jaoul & Delphine Tharaud
– Nombre de pages : 232
– Sortie : printemps 2020
– Prix : 39 €
– ISBN / EAN : 979-10-92684-45-2
/ 9791092684452
– ISSN : 2259-8812
Présentation :
Si le tatouage a longtemps été réservé aux mauvais garçons, aux prisonniers et aux marins, ce dernier se normalise au point de devenir commun. Face au nombre grandissant de tatoués et de tatoueurs, de nouvelles questions se posent tant aux artistes tatoueurs qu’aux clients. Les problématiques qui se posent sont nombreuses : pratique du tatouage, liberté d’installation, propriété intellectuelle, formation des jeunes tatoueurs, statut du tatoueur et en fond son imposition, droit du travail, déontologie, contrats de mise à disposition de locaux aux tatoueurs permanents ou guests invités… Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion qui a été menée lors d’un colloque qui s’est tenu à Limoges en juin 2019 avec l’objectif d’apporter des réponses aux différents opérateurs du monde du tatouage.
Parce que le tatouage est un phénomène de société, il convenait de se demander s’il était devenu un objet juridique à part entière. La réponse est positive. Au terme des débats qui vous sont livrés dans cet ouvrage, il est passionnant de voir à quel point la matière est vivante et nécessite que les juristes s’y intéressent. De l’histoire du tatouage à l’évolution sociologique qui entoure les mutations de la pratique, du statut du tatoueur au contrat de tatouage, des enjeux pour le tatoueur notamment en propriété intellectuelle à ceux du tatoué, ces actes cherchent à apporter des réponses aux interrogations actuelles et à anticiper celles de demain au travers du triptyque : tatoueur, tatoué & tatouage.
Tatouages,
Barbes & Moustaches
(Tbm) dans les
fonctions publiques *
Mathieu Touzeil-Divina
Professeur de droit public, Université Toulouse 1 Capitole, Imh
Président du Collectif L’Unité du Droit
« Du côté de la barbe est la toute-puissance » !
Molière –L’école des femmes.
Théorie « des » ou droit « aux » apparences ? Parmi les questions juridiques que le présent ouvrage collectif pose, à l’invitation de Mélanie Jaoul, existe selon nous l’interrogation relative à l’apparence du travailleur dans son emploi public ou privé. Considéré « trop » barbu tel un hipster new-yorkais sous 3-mmc, un rabbin loubavitch… ou un musulman salafiste, présentant des piercings ou des scarifications faisant peur aux grands-parents, tatoué[1] sur les membres apparents ou le visage à l’instar d’anciennes traditions polynésiennes ou d’un souvenir de beuverie, de prison ou encore de légion(s), le travailleur public ou privé ne peut pas toujours se présenter à ses employeurs, à ses collègues et à un éventuel public ou à une potentielle clientèle comme il l’entendrait ou le désirerait seul. Ici encore existe un « droit de ». En l’occurrence un droit des travailleurs qui ouvre une branche : celle des apparences et du physique.
Restrictions scientifiques. A priori, la plupart des questions
ici envisagées seront communes aux travailleurs des droits privé et public
(fonctionnaires compris). Toutefois, parce que nous ne sommes pas spécialisé en
droit du travail, nous considérerons principalement les éléments relatifs aux
travailleurs publics qui nous sont plus familiers. Et, parce qu’il sera
impossible en ces pages de traiter de toutes les hypothèses d’apparences
physiques des agents publics, on restreindra – principalement – nos propos aux
ports des tatouages[2],
barbes et moustaches (dorénavant Tbm)[3]. En
traitant ici « des » fonctions publiques, on veut par ailleurs
signifier deux éléments. D’abord, au sens strict, on s’intéressera
principalement aux agents titulaires de l’une des trois fonctions publiques françaises
d’Etat, de la territoriale et de l’hospitalière tels qu’institués et régis
unilatéralement par le statut général de la Loi du 13 juillet 1983 (c’est-à-dire
tout agent exerçant un emploi permanent auprès d’une personne publique en ayant
été nommé dans un grade de la hiérarchie le tout dans une position dite
statutaire et réglementaire).
Par ailleurs, on ne s’interdira pas, lato sensu, d’envisager
également certains cas d’agents contractuels – titulaires ou non (en Cdd ou en Cdi) – au service de la puissance publique au sens large. Il
ne s’agit effectivement pas d’insister sur les différences entre statutaires et
autres personnels mais de considérer globalement les travailleurs de droit
public.
Quels droits et/ou libertés en jeu ? S’habiller ou se coiffer de
telle façon, faire pousser ou non les poils de sa barbe et/ou de sa moustache[4],
découvrir, dissimuler ou suggérer un tatouage sur son corps d’agent public
met-il en jeu un droit ou une liberté[5] ?
Il n’existerait pas de « liberté fondamentale » à se vêtir comme on l’entendrait
affirme la Cour de cassation[6] même
s’il s’agit vraisemblablement là d’un corolaire de la liberté individuelle. Un
droit à son identité. Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme[7], il
est en revanche fondamental de protéger les « choix faits quant
à l’apparence » par les individus et ce, dans l’espace « public
comme en privé ». Il s’agit bien du droit – fondamental – à la vie
privée (art. 08 Cesdhlf) qui garantit[8]
« l’identité physique, psychologique et sociale d’un individu ».
Quoi qu’il en soit, c’est surtout la notion constitutionnelle d’Egalité
qui entre ici en jeu lorsqu’un agent public est barbu, moustachu et/ou tatoué.
Au nom de l’Egalité, l’interdiction de
discriminations physiques. A priori (et l’on voudra bien garder en tête qu’il s’agit
là d’un a priori principiel particulièrement compliqué à démontrer dans
les faits)… a priori – donc – un employeur – public ou privé – ne peut
refuser de recruter, ne peut sanctionner ou même licencier un travailleur au
regard d’un détail de son apparence physique qui lui déplairait. C’est l’application
du principe constitutionnel d’Egalité[9] qui
interdit tout traitement différentiel, toute « rupture », toute
discrimination à moins – précisent plusieurs normes acceptées par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel – qu’un intérêt général engage le
législateur, par exemple, à régler[10]
« de façon différente des situations différentes » et ce, de
façon objective. Autrement dit, s’il n’y a pas véritablement de situation
analogue ou comparable, des discriminations peuvent être opérées ! Ainsi,
permettra-t-on, y compris dans l’emploi public par l’intermédiaire par exemple
du Pacte[11]
(Parcours d’Accès aux Carrières de la fonction publique Territoriale, hospitalière
et d’Etat) à des citoyens peu qualifiés (et considérés placés dans une
situation objectivement différente) d’intégrer plus facilement (que ceux qui
seraient diplômés) des emplois de catégorie C des trois fonctions publiques.
Afin de résorber le non-emploi des sous-qualifiés (c’est l’objectif affiché d’intérêt
général), on cherche à les favoriser en créant à leur profit une discrimination
dite positive[12].
L’Egalité est bien l’un des plus beaux aspects de notre fonction
publique : sa négation des privilèges d’Ancien régime où ne devenaient
agents publics que ceux adoubés par le Prince. Désormais, affirme depuis août
1789 l’article 06 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (à
valeur désormais constitutionnelle), les agents publics ne seront recrutés et
traités qu’en considération égale de leurs talents et de leurs vertus.
Normes travaillistes & publicistes. En droit privé, le Code du
travail dit explicitement (art. L. 1132-1) qu’aucune « personne ne peut
être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un
stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou
indirecte, (…) en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de
son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation
de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la
particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue
de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son
lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de
santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer
dans une langue autre que le français ». De manière plus générale
encore, le Code pénal (art. 225-1), prohibe toute « distinction opérée
entre les personnes physiques » notamment « à raison (…) de
leur apparence » et – tout aussi explicitement – les statuts
applicables aux fonctions publiques connaissent des dispositions similaires et
ce, à l’article 06 de la Loi statutaire du 13 juillet 1983[13] :
« La liberté d’opinion est garantie aux
fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être
faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques,
syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation
sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur
situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence
physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de
tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ».
Il n’est donc pas douteux que le principe d’Egalité s’applique aux
éventuelles questions de discriminations d’apparence physique des agents
publics. Il est du reste dommage, pourtant invité en ce sens par le Défenseur
des droits[14],
que le législateur n’ait pas saisi le moment du vote de sa récente « Loi
de transformation » de la fonction publique[15] pour
y insérer un article exactement similaire à celui du Code du travail.
Unité du Droit. Quoi qu’il en soit, il est certain que le principe
de prohibition d’une discrimination physique est a priori identique,
dans sa généralité au moins, s’agissant des employeurs privés comme publics et
ce, même si le fondement juridique n’est pas – encore – exactement le même et
que la fonction publique met en avant immédiatement deux particularités (à l’art.
06 précité du Statut) : d’abord, la primauté de la liberté d’opinion et
ensuite l’existence d’exceptions pour « tenir compte d’éventuelles
inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions » et (mais de
moins en moins) en considération de l’âge. Ainsi, n’est-il pas discriminatoire
d’interdire à un aveugle d’être tireur d’élite ou pilote d’avion de chasse. Il
s’agit d’une particularité physique audible dans ce type d’emplois publics.
Matérialité de l’apparence physique discriminée. Concrètement, il est ainsi
estimé discriminatoire (et donc réprimé) le comportement d’un employeur qui
sanctionnerait un travailleur qu’il considérerait (sans rapport avec des
impératifs de sécurité ou d’intérêts général ou d’entreprise) trop gros, à la
coupe de cheveux improbable, aux taches de rousseur trop visibles, à l’acné
juvénile bien tardive ou encore parce qu’il serait roux, albinos et ou affublé
d’un strabisme déconcertant.
Il en est manifestement de même – concernant la présente étude – si un
travailleur était sanctionné du fait même d’un port de barbe, de moustache ou
de l’existence (supposée ou réelle et visible) d’un (ou de plusieurs)
tatouage(s) sur son épiderme.
Il s’agit bien là de l’apparence physique d’une personne travailleuse.
I. Des uniformes « au poil » mais sans
tatouage ?
Du corps aux vêtements en passant par l’uniforme. Dans l’emploi public, cela
dit (mais parfois aussi en emploi privé), une fonction peut impliquer le port
de vêtements professionnels qualifiés d’uniformes. Rappelons à cet égard que c’est
précisément au nom de l’Egalité et de l’Unité des fonctions publiques qu’il
peut être imposé à des agents (outre les raisons professionnelles de port de
vêtements spécialisés en raison de matériaux techniques[16] et
propres aux missions délivrées) de faire disparaître leur individualité
derrière des atours les rendant « uniformes[17] »
et n’exprimant que les fonctions incarnées les dépassant. Ainsi sont-ils
reconnaissables, par leurs vêtements, les magistrats judiciaires, les
policiers, les éboueurs, les sapeurs-pompiers, les militaires, les
infirmiers, etc. C’est la fonction publique qui prime ici au
détriment de l’individu.
Par principe (et avec de rares exceptions par exemple lorsque l’agent n’est
jamais confronté à des échanges avec le public[18] ou
avec des administrés), le refus de porter l’uniforme imposé ou son
travestissement entraîne des sanctions professionnelles[19].
L’Uniforme prohibe a priori la
modification d’apparence physique. Or, le principe même de « l’uniforme »
rendant « uniforme » prohibe, par principe,toute modification
de l’apparence physique. Si le port d’une barbe ou de moustache ne choque pas
nécessairement directement la vocation uniforme, un tatouage ou une
modification corporelle – visible outre l’uniforme – en revanche peut paraître
incompatible avec l’apparence de l’agent public. Il en serait ainsi par exemple
d’un policier au visage ou aux mains tatoués mais, ainsi qu’on le verra infra
dans nos développements, les corps de fonctionnaires en uniformes semblent
plutôt se diriger, comme la société française dans son ensemble, vers une
acceptation ou tolérance croissante de ces questions. De nombreux employeurs
(publics comme privés) précisent cependant dans leurs normes internes qu’une[20]
« présentation soignée » est attendue des agents,
particulièrement s’agissant de ceux en contact avec le public ou les
administrés.
L’antique port obligatoire des moustaches de l’autorité. Il a même existé, on le sait, en France comme dans plusieurs pays, des corps (comme celui désormais célèbre y compris dans l’imaginaire collectif) où, longtemps, on a imposé aux agents publics une apparence faciale pileuse, outre l’uniforme se remémorant peut-être ces mots de Molière : « du côté de la barbe est la toute-puissance » ! Ainsi, connaît-on la circulaire du 20 mars 1832[21] imposant, à l’initiative du Maréchal Maison, la moustache[22] à tout militaire. Plus précisément apprend-on encore par un acte postérieur du 03 juin 1836[23] que la moustache militaire devra être taillée « uniformément au niveau de la lèvre supérieure, s’étendre sans discontinuité sur toute la longueur de la lèvre et s’arrêter toujours au coin de la bouche ». Selon le lieutenant-colonel Edouard Ebel[24], cette obligation pileuse aurait été imposée en 1836 à tous les militaires à l’exception des gendarmes. Or, « cette sentence très mal perçue par l’Arme, [fut] vécue comme une humiliation et [souleva] un véritable tollé » si bien qu’en 1841, grâce au maréchal Soult, la moustache fut à nouveau imposée à tous les porteurs de l’autorité qui la revendiquaient. Plusieurs normes (et surtout des circulaires) ont effectivement imposé (avec un recul lors de la Première Guerre mondiale[25]) – à fins dites d’autorité – d’arborer non pas une barbe, symbole de la liberté et du poil non maîtrisé, mais une fine moustache taillée et travaillée : ordonnée et au pas cadencé !
Ce n’est alors qu’en 1933[26] (par
l’alinéa 1er in fine de l’art. 25 du décret du 1er
avril 1933) que l’obligation s’évanouit par une fin de phrase venant totalement
déstructurer le principe liminaire énoncé :
Les militaires « portent
les cheveux courts, surtout par derrière, la moustache avec ou sans la mouche
mais couvrant la lèvre supérieure ou la barbe entière ; ils peuvent également
être entièrement rasé ».
Les brigadiers sont ainsi d’ailleurs devenus dans l’inconscient
collectif (comme par exemple chez Fred[27] dans
Philémon) des « brigadiers à moustache » aussi
caractéristiques et parfois caricaturaux que le gendarme du théâtre de Guignol.
L’uniforme jusqu’aux
poils ! Ainsi[28], l’uniforme
des fonctions publiques notamment n’a pas concerné que les vêtements.
Longtemps, les cheveux et les poils (de barbes et de
moustaches) des agents publics ont été régis par les religions[29] et
par la Puissance publique. On se souvient ainsi que sous l’Ancien Régime et
même après la Révolution, l’usage puis la norme avaient réservé le port des
cheveux longs ou ronds (d’où l’arrivée des perruques en crin de cheval le
permettant plus aisément[30]) aux
seuls nobles dont les gens de Justice. Un arrêté du 02 nivôse an XI en témoigne
ainsi que de très nombreux portraits d’Ancien Régime ou même postérieurs à
1789.
Enfin, il est impossible de ne pas évoquer ici la
célèbre affaire du Tribunal d’Ambert[31]
ayant conduit à la décision de la Cour de cassation (alors sous la présidence –
pour la chambre des requêtes – du baron Zangiacomi) ;
décision du 06 août 1844 qui rejeta le pourvoi de trois avocats moustachus et
consacra conséquemment la solution souveraine des juges du fond selon laquelle
la moustache des robins[32] qui
avaient osé défier l’autorité en ne venant pas le duvet rasé ce qui constituait
une[33]
« tenue négligée, peu en rapport
avec les habitudes du Barreau, contraire à ses usages et ses traditions »
c’est-à-dire une « atteinte portée à
la dignité de la Justice et une irrévérence envers ses magistrats » !
Le petit manuel de la moustache et de la barbe[34]
mentionne à cet égard le sentiment du Bâtonnier qui y avait également vu une
« provocation irrespectueuse, une
opposition préméditée, une résistance individuelle et outrageante à un ordre de
police intérieure ». Le même manuel relate également cette audace d’un
avocat parisien qui, en 1868, osa plaider devant le Tribunal de la Seine :
« je cherche vainement l’ordonnance
qui règle la nudité de ma lèvre ».
Mais ces questions ne sont pas si anciennes.
Mentionnons en effet, plus proche de nous, ce jugement du Tribunal
Administratif du 03 juin 1986 d’Amiens (« Seckel »). Il s’y est agi d’une sanction d’un garde
forestier à qui l’on reprochait sa coupe de cheveux « incompatible avec [sa] fonction
d’autorité ». Il avait en l’occurrence les cheveux rasés et une unique
« mèche frontale » (sic).
Des poils
obligatoires des agents publics aux « poilus ». Le poil des moustaches (et
non des barbes) a ainsi été – un temps – assimilé – officiellement à l’uniforme
d’autorité militaire. Pourquoi ? Car la langue, notamment française, a
associé sinon assimilé la virilité, la force et le courage à l’abondance
pileuse du visage. En témoigne l’adjectif même de « poilu[35] »
qui va devenir un substantif synonyme de « soldat ».
Le fonctionnaire militaire français est un
moustachu : un poilu.
Il en va différemment de la perception de la barbe
ainsi qu’on le rappellera infra.
L’absence de tatouage obligatoire des agents
publics.
Cela dit, en droit français (sur le territoire métropolitain tout du moins), il
n’a a priori pas existé d’obligation normative de tatouer un agent
public du fait de sa fonction. L’hypothèse de quelques usages bagnards[36] n’est
effectivement pas à prendre ici en compte car il s’agit d’usagers contraints et
non d’agents du service public pénitentiaire.
II. Une tolérance croissante
des apparences & de la diversité :
vers un droit des agents publics aux Tbm
Parmi les discriminations dans l’emploi, celles relatives à l’apparence
physique ne sont pas les plus fréquentes même si leur perception n’est pas
anecdotique pour autant ainsi qu’en atteste l’un des derniers[37]
« baromètres » publiés par le Défenseur des droits en
partenariat avec l’Organisation Internationale du Travail. Un quart des travailleurs
(publics comme privés de façon similaire[38])
aurait ainsi été confronté à la perception d’une discrimination à l’embauche[39] ou
dans son emploi ce qui serait principalement matérialisé par des actes ou
propos racistes, liés aux sexualités, à la santé et sexistes. Toutefois, la
question de discriminations liées à l’apparence physique existe ainsi que le Défenseur
des droits l’avait d’ailleurs particulièrement mis en évidence lors de la
publication, en 2016[40], de
son IXe « Baromètre » précisément intitulé :
« le physique de l’emploi » ainsi, plus récemment, que dans sa
décision-cadre 2019-205.
Les codes vestimentaires adoptés, la corpulence (et notamment le
surpoids) d’un travailleur ou d’une travailleuse, sa « coiffure »,
ses « tatouages » ou éventuels « piercings »
peuvent manifestement conditionner des réactions hostiles dans l’emploi. Un
sondage fait alors apparaître que pour plus d’un tiers des travailleurs
interrogés, il est « inacceptable quelle que soit la situation »
qu’un agent soit sanctionné du fait d’un tatouage alors que pour encore près de
10% des exprimés, cette discrimination est tout à fait compréhensible !
Heureusement (pensons-nous), ceci évolue mais il est évident, au regard des
différents Baromètres précités et consultés que si vous êtes agent
public et cumulez certaines catégories ou pratiques, votre potentiel de subir
des discriminations s’élève. Il en va ainsi des femmes non blanches non
catholiques de plus de quarante-cinq ans, non hétérosexuelles, tatouées,
percées et en surpoids. Tel est le combo perdant et stigmatisant.
La traduction sinon l’acceptation des
comportements sociaux. On estime que la pratique du tatouage[41]
depuis une quinzaine d’années est telle dans la société française que bientôt
deux personnes majeures sur dix en détiendraient sur leurs peaux. Côté barbes
et moustaches, depuis 2010, leur port est revenu à la mode et le phénomène australien
Movember est désormais globalisé.
Les deux matérialisations (visages pileux et corps tatoués) ne sont ainsi
pas ou plus des expressions mineures ou réservées à certaines catégories
sociales ou à certains milieux.
C’est la société notamment française, dans toutes ses dimensions, qui
connaît ces phénomènes. En 2014, aux Etats-Unis d’Amérique une pétition a ainsi
réussi à faire plier la chaîne Starbucks pour qu’elle cesse de
discriminer les serveurs tatoués. En 2020, le barbu n’est donc pas (ou plus
nécessairement perçu comme) un dangereux gauchiste négligé, un religieux
ultra appliquant les préconisations du Lévitique (19.27). De même le
tatoué n’est pas (ou plus) un marginal, un « mauvais garçon », une
« mauvaise fille » aux vertus questionnées, un ancien prisonnier[42]. La
société tout entière s’est convertie à ces expressions et les fonctions
publiques, pour une fois, semblent s’y adapter.
Un rapport[43]
a particulièrement accompagné cette prise en compte de la diversité sociale et
de ses apparences physiques. C’est celui remis, en 2016, par le professeur L’Horty au ministère de la fonction
publique (lorsqu’il en existait encore un). Démontrant, chiffres et pratiques à
l’appui, que la diversité ne rimait pas (toujours) avec l’emploi public où les
discriminations à l’emploi existeraient de façon durable sinon
institutionnalisée, le document universitaire a fait l’effet d’une bombe
qu’heureusement les gouvernants successifs semblent ne pas avoir – totalement –
ignorée.
Désormais, les fonctions publiques voudraient incarner davantage tous les
visages de la société et donc, y compris, ceux des barbus et des tatoués. On s’en
réjouira.
L’évolution récente des fonctions publiques d’autorité. Même les fonctions
publiques d’autorité (comme l’armée ou la police) semblent avoir cédé à la
demande sociale notamment exprimée depuis les années 2010 par les syndicats[44].
En effet, alors que, selon les localisations, certains
policiers étaient autorisés à porter la barbe ou à ne pas dissimuler leurs
tatouages, d’autres pratiques les prohibaient totalement au nom de l’Egalité
uniforme créant, de facto, des ressentis inégalitaires. Après cinq années
d’échanges (et parfois d’avancées puis de reculs), la Direction Générale de la
Police Nationale (Dgpn) a pris une
instruction[45]
(datée du 12 janvier 2018 ; Nor :
Intc 1801913J) permettant le port
encadré des « tatouages, barbes et moustaches, bijoux ou accessoires de
mode par les personnels affectés dans les services de la police nationale ».
Cette circulaire prise
par le préfet Morvan, directeur de
la Dgpn prend acte de ce que les
piercings et les Tbm ne sont pas
qu’un effet de « mode » mais bien « un phénomène
culturel et de société ». En conséquence, conclut la direction, tant
que les règles de déontologie et l’ordre public ne sont pas atteints et que les
coupes des cheveux et poils faciaux demeurent « courtes, soignées et
entretenues, sans fantaisie, compatibles avec le port des coiffes de service »,
rien n’empêche a priori un agent de porter barbe, moustache ou tatouage(s).
Après avoir posé ce principe, l’instruction mentionne deux exceptions
principales (que l’on retrouve, du reste, en toute profession) :
- lorsqu’est en jeu la sécurité (par exemple pour une barbe
trop longue d’un représentant des forces publiques au point qu’un manifestant
pourrait s’en saisir contre l’agent lui-même ou parce qu’il ne pourrait pas
porter par exemple un masque à gaz[46] ou à
propos de piercings ou d’autres bijoux qui pourraient être retournés contre
leurs porteurs) ;
- et s’agissant d’un port incompatible avec les obligations
déontologiques de neutralité des agents (par exemple s’agissant d’une croix
gammée).
Enfin, souligne l’acte para-réglementaire, au visa du Code de la sécurité
intérieure (art. R. 434-1 et s.) applicable aux gendarmes et aux policiers et
spécialement vis-à-vis de l’art. R. 434-14, « le policier ou le
gendarme est au service de la population. Sa relation avec celle-ci est
empreinte de courtoisie (sic) et requiert l’usage du vouvoiement (re sic) ».
Au nom de la « dignité des personnes », l’instruction souligne
une circonstance particulière : tout agent positionné en uniforme et/ou en
contact direct avec le public se doit d’être particulièrement exemplaire
(principe que l’on va retrouver applicable à toute profession).
La tradition des corps d’armées : les corps pileux
notamment tatoués. Ainsi qu’on l’a rappelé supra, les corps d’armées ont connu
jusqu’en 1933 une obligation normative pileuse. En revanche, rien n’imposait à
ces corps d’être tatoués. Toutefois, si rien ne l’obligeait et ne l’oblige
encore officiellement, ont longtemps existé – et existent encore – des
traditions et des usages en matière de tatouages. La Marine[47] dans
de nombreux pays en est peut-être, avec la Légion étrangère, le corps le plus
topique et ce, s’agissant des marins, singulièrement dans les pays anglo-saxons[48]. Ici
le Droit écrit ne compte (presque) plus s’agissant au moins de l’apparence
physique : la force de la tradition des communautés d’individus aux rites
propres aux groupes s’impose. Comme autrefois lorsque la métropole acceptait qu’une
colonie (parce qu’elle était éloignée et concernait moins de monde) bénéficiât
d’exceptions, les marins et les légionnaires (parce qu’ils sont la plupart du
temps éloignés du territoire métropolitain et qu’ils ne sont pas si nombreux)
voient leurs signes identitaires s’affirmer sous l’œil tolérant et complice de
la République.
Le travailleur accueillant (ou non) du public. Cette parenthèse marine
refermée, il faut aborder le principe cardinal de notre étude : la
confrontation de l’agent au public. En effet, en droit public comme en droit
privé, ne pas revêtir correctement un uniforme donné ou ne pas manifester une
apparence physique jugée digne est susceptible de sanction(s). Il s’agit bien
d’une faute professionnelle ainsi que l’a éprouvé un gardien de prison du
centre corrézien de détention d’Uzerche qui a reçu un avertissement du
directeur régional des services pénitentiaires parce qu’il avait effectué une
partie de son service (la surveillance de détenus pendant des activités
sportives) en baskets ! « Pas
de Tn pour les matons » a
également estimé, après l’employeur public, le Tribunal Administratif de
Limoges[49]
(jugement n°01-1514 du 06 mai 2004). Ce dernier relevant que la mission de
surveillance précitée « n’impliquait
aucunement » que le gardien « prenne
part aux activités sportives en cause » ! Il en est de même en
droit privé[50].
La jurisprudence en matière de tenues et/ou d’apparences physiques jugées
inappropriées est assez claire, même si elle relève d’une appréciation toujours
circonstanciée et propre aux fonctions exercées.
Un agent en contact direct avec le public n’est ainsi pas placé dans la
même situation (et avec les mêmes obligations de soin de son apparence
physique) qu’une ou un collègue placé dans un bureau ou un atelier ne recevant
pas d’administrés ou de clients.
Si l’employeur peut donc imposer une « tenue » / « apparence »
particulière et conforme à l’emploi considéré, il ne peut pas pour autant tout
sanctionner ou refuser.
Résumons-nous : par principe l’employeur public
(comme privé) ne peut – sans causer de discrimination (et donc en être
condamné) – refuser d’employer ou sanctionner lui-même (jusqu’au licenciement)
un travailleur barbu, moustachu et/ou tatoué parce qu’il serait barbu,
moustachu et/ou tatoué. L’Egalité s’affirme.
- En revanche, s’il existe un impératif d’ordre public (comme
celui de sécurité) ou une contrainte professionnelle particulière avérée, les
ports précités pourront être restreints. Ainsi, un agent travaillant avec des
produits combustibles ou avec de la pyrotechnie pourrait voir le port de sa
barbe (inflammable) contraint.
- Surtout, si l’agent est en contact avec le public, il ne doit
choquer ou porter atteinte à la dignité de personne. C’est évidemment ce
dernier critère – le plus subjectif – qui donnera lieu aux appréciations les
plus difficiles et circonstanciées. Ce qui sera permis pour un enseignant-chercheur
s’adressant à un public majeur ne le sera pas nécessairement pour un professeur
des écoles. Ce qui sera admis pour un policier ou d’un gardien de prison ne le
sera pas nécessairement d’un magistrat, etc.
Il faut ici mentionner l’existence de la décision-cadre 2019-205[51] du Défenseur
des droits qui permet non seulement de résumer l’état du Droit mais encore
d’attirer l’attention des employeurs sur le risque de discriminations. En
effet, rappelle le document, les caractéristiques physiques peuvent être
considérées et contraintes par l’employeur public ou privé si elles répondent à
« une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour
autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ». Ce
sont les rares exceptions qui seront développées infra. La
décision-cadre signale par ailleurs que selon elle « le contact avec
les usagers, l’exercice d’une fonction d’autorité ou la relation avec la
clientèle ne permettent pas, à elles seules, de justifier toutes les
restrictions ». Tout est donc bien affaire d’appréciation
circonstanciée dans cette appréhension de l’apparence physique que le Défenseur
définit ainsi au point 27 : « l’ensemble des caractéristiques
physiques (sic) et des attributs visibles propres à une personne,
qui relèvent tant de son intégrité physique et corporelle (morphologie, taille,
poids, traits du visage, phénotype, stigmates etc.) que d’éléments liés à l’expression
de sa personnalité (tenues et accessoires vestimentaires, coiffure, barbe,
piercings, tatouages, maquillage, etc.) ». Les Tbm sont ainsi bien concernés.
III. Le refus des messages appréhendés comme politiques, religieux ou porteurs de propos prohibés dans l’espace public
Si la tolérance des apparences physiques semble croissante, demeurent
deux exceptions : celles de certains « messages » prohibés dans
l’espace public et la question, tout aussi croissante, de la véritable
« peur » du religieux (notamment musulman) et des manifestes
fantasmes qu’elle véhicule.
L’antique interdiction de la barbe gauchiste. Si la moustache a été
réglementaire dans l’uniforme public militaire, la barbe n’a pas connu le même
engouement. Sous l’Ancien Régime, rappelle ainsi Glasson[52], on
trouve une ordonnance royale de 1540 « qui
défendait à tous juges, avocats et autres, de porter barbe et habillements
dissolus » mais l’on sait également que le port de la barbe et de la
moustache dans la magistrature fluctua selon les siècles et notamment les modes
suivies par l’Eglise et ou le Souverain. En 1974, l’article 11 du Règlement
intérieur d’emploi des gradés et gardiens de la police nationale[53]
interdisait même explicitement son port sans exception. Il est désormais toléré
mais accepté seulement s’il est court.
La barbe longue demeure en effet dans l’inconscient
collectif celle des dangereux révolutionnaires dits gauchistes. A l’Université,
ainsi, on se souvient que plusieurs normes ont régi les usages capillaires[54]. Le
20 mars 1852, la circulaire Fortoul
du ministre de l’Instruction publique interdisait aux enseignants de porter
barbes et moustaches. Ces premières, « peu
compatibles avec la gravité du professorat » étaient, sous le Second
Empire, perçues comme un signe d’opposition au pouvoir impérial. Alors,
commentait-on « Hugo, qui a commencé sa carrière joues
nues, se laissa croître le poil à mesure qu’il se gauchisait »[55] !
Plus tard, expliquera même Pier Paolo
Pasolini : « le langage de ses cheveux exprimait, même
indiciblement, des « choses » de gauche » !
A l’Opéra où se produisent notamment des agents
publics, la question a même été posée devant les tribunaux : les artistes
(que l’Etat rétribuait directement ou non) avaient-ils en conséquence le droit,
sans offenses, de paraître sans être glabre ? Et l’auteur du code du
théâtre[56] de
répondre en résumant la jurisprudence : « l’artiste est tenu de se soumettre à toutes les exigences de ses rôles
et de son emploi » ; « il
doit en faire le sacrifice (sic) chaque fois que les
besoins du service l’exigent ». Force est alors de constater qu’en 2020, toujours, la barbe
longue est encore mal perçue. L’instruction précitée de 2018 applicable aux
gendarmes et policiers y insiste : si barbe ou moustache il y a : la
coupe en sera courte et soignée « sans fantaisie ». A la fin
du XIXe siècle, de même, lorsque les poils faciaux étaient tolérés
jusque dans les corps armés, il était bien précisé qu’ils seraient taillés et
ordonnés et non libres et longs à la seule exception, peut-être, de la barbe
longue étonnamment acceptée chez les sapeurs[57] et
ce, peut-être du fait du patronyme de leur sainte-patronne. C’est cet état que
décrit la théorie militaire et administrative de Cochet de Savigny[58].
Plus récemment (avant l’instruction de janvier 2018), certains médias[59] ont
même évoqué dans les corps armés et chez les Crs
par exemple de véritables « chasses aux barbus » et l’existence
d’une « note de la direction zonale des compagnies républicaines de
sécurité » du 1er mars 2017 pour la région Est. Selon cette
instruction : « à compter de ce jour est mis en place un tableau
mensuel recensant le nombre de fonctionnaires porteurs de barbe ou de bouc ».
Heureusement pour les Crs barbus,
la circulaire Morvan a modifié cet
ordre étonnant daté de 2017 mais respirant les siècles passés. Cela dit, l’art.
90 du règlement intérieur des Compagnies Républicaines de Sécurité continue d’affirmer
l’interdit de la barbe aux Crs à
moins d’une autorisation explicite du chef de service central des Crs.
La traduction des interdits (notamment de
sécurité) de l’espace et de l’ordre publics. Ainsi, les éléments matériels permettant de
justifier l’interdit vestimentaire ou d’apparence physique sont rares. Il
existe effectivement quelques obligations dues à des emplois spécifiques et dangereux
(où l’on va par exemple manipuler des produits dangereux), quelques exigences d’hygiène
(en contact avec des produits alimentaires ou de santé notamment) et de
sécurité (pour les agents ou le public qu’ils côtoient) mais ces éléments
matériels sont plutôt et si objectivement circonstanciés qu’ils ne posent, au
contentieux, que peu de difficulté(s). Ainsi, un Crs avec une barbe de cinquante centimètres pourra entendre
qu’il est dangereux pour sa sécurité qu’un potentiel manifestant s’y agrippe.
Une infirmière comprendra également que le tatouage à propos duquel elle a une
réaction cutanée vive et qu’elle vient de réaliser pourrait être mal perçu
sinon craint des patients et de sa hiérarchie lui demandant d’agir en milieu
stérile. Concrètement, par exemple, l’instruction Morvan précitée nous indique, à propos des policiers, qu’afin
« de respecter les exigences de sécurité et la nécessaire étanchéité du
matériel prescrite par le fabricant, le port de la barbe ou des favoris ne
pourra pas être autorisé lors de 1 ‘utilisation des équipements spéciaux de la
tenue Nrbc, à 1’ exception des
entraînements et exercices » ; ladite tenue étant celle des
opérations Nucléaires, Radiologiques, Biologiques et Chimiques.
Le refus des symboles explicites contraires à la neutralité. La recherche des « Tbm déontologiques ».
Plus complexe à appréhender est la justification d’éléments non matériels mais
psychologiques ou spirituels. Il en est particulièrement ainsi des tatouages
dont on peut se demander comment les appréhender au regard de la liberté de se
vêtir, d’assumer son apparence physique et in fine de la liberté d’expression[60].
« Mort aux vaches » ou « aux cons », croix
gammée, injures et autres propos diffamants, racistes, antisémites ou encore
xénophobes : il est évident que si ces expressions étaient verbalisées en
public ou entre collègues par un agent public, elles seraient sanctionnées. Il
n’y a donc aucune raison pour qu’un tatouage qui traduirait les mêmes
matérialisations soit acceptable et accepté. Tout ce qui est contraire à l’oral
ou par le derme coloré aux obligations déontologiques et statutaires et –
évidemment – aux Lois de la République est et doit être sanctionné. Il en va
conséquemment s’ils sont visibles des collègues, de la hiérarchie ou évidemment
du public de tatouages qui :
- seraient injurieux ou diffamants (comme des doigts sur
lesquels seraient écrits « Vtff »
ou encore « Bastard », « Fuck off » ;
- porteraient atteinte à la neutralité du service dans toutes
ses dimensions (religieuse, politique, philosophique, etc.) à l’instar
de messages tels que « à bas la République ! », « Vive
le Rassemblement National ! » ou même de logotypes de partis ou d’idéaux
politiques partisans ;
- en particulier manifesterait un prosélytisme ou un
dénonciation d’une religion ou d’un comportement religieux donné (ce qui serait
contraire au principe de Laïcité à la différence du port d’une barbe) et ce, à
l’image d’un verset, d’une représentation biblique, satanique, etc.
Bien entendu, ici comme souvent en Droit, tout sera question d’appréciation
et d’interprétation in concreto. Un message certes biblique comme
« aimez-vous les uns les autres » serait potentiellement
accepté ; une rose au poing pourrait même l’être s’il ne s’agit pas du
strict logotype du parti socialiste. On part donc ici – en pratique – à la
recherche des Tbm déontologiques
ou conformes aux déontologies et pratiques professionnelles. Au contentieux,
citons cet arrêt du Conseil d’Etat[61]
confirmant le renvoi (rare avant même sa titularisation et la fin de sa période
d’essai) d’un fonctionnaire stagiaire (en l’occurrence surveillant
pénitentiaire) qui avait diffusé (notamment sur réseaux sociaux) ses
préférences politiques extrémistes et l’existence sur son corps d’un tatouage
néonazi. Même non visible en permanence, le fait que l’intéressé ait rendu
publiques la connaissance et l’existence de ce tatouage au message prohibé car
contraire à la neutralité du service public a suffi.
Saintes barbes prosélytes ? Deux dernières hypothèses pour
terminer notre panorama des Tbm
dans les fonctions publiques : les sapeurs-pompiers et la barbe dite
prosélyte. S’agissant des premiers, on a rappelé supra que le port de la
barbe leur avait un temps été reconnu (à la différence des militaires) mais –
en toute hypothèse – de nos jours il demeure plus rare et ce, d’autant plus que
l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et
attributs des sapeurs-pompiers n’y incite pas véritablement. Son article 08
dispose en effet que « pour des raisons d’hygiène et de sécurité » :
« le port de bijoux apparents (dont les boucles d’oreilles et les
piercings) n’est pas autorisé ; les cheveux doivent être d’une longueur
compatible avec le port d’une coiffe ou être attachés ; le rasage est impératif
pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la
moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité
optimale du port des masques de protection ». Donc, certes, la barbe
est autorisée mais à titre exceptionnel et courte et bien taillée.
Rien à voir, cette fois, avec l’univers des sapeurs-pompiers et celui de
leur « sainte patronne » (Sainte-Barbe)
d’appropriation étonnamment républicaine, parlons maintenant de la
« barbe » à connotation religieuse. On a compris qu’a priori tout
agent public peut porter la barbe (au besoin courte et taillée dans certaines
fonctions où des exigences sécuritaires ou de port de coiffes l’impliquerait)
mais il est clair qu’en tant que tel le port d’une barbe ne saurait être
interdit. Pourtant, une jurisprudence vient ternir ce principe et elle nous
semble singulièrement détestable. Il s’agit de l’arrêt de la Caa de Versailles en date du 19 décembre
2017[62] qui
a considéré à travers l’existence d’une barbe « particulièrement
imposante » une « appartenance religieuse » contraire
au principe de laïcité. Même si le 25 décembre approchait, il ne s’agissait
évidemment pas de la barbe du Père noël ou de celle de Saint-Nicolas mais de celle d’un stagiaire
associé à un centre hospitalier qui y était normalement accueilli du 4 novembre
2013 au 2 novembre 2014. Toutefois, le 13 février 2014, l’établissement de
santé l’accueillant avait unilatéralement mis fin au stage de l’intéressé qui
en a contesté la décision auprès du TA de Montreuil (qui a rejeté sa demande)
et en appel devant la Caa de
Versailles qui a également débouté l’intéressé. Mettons de côté les éléments de
procédure disciplinaire (qui ici n’apportent que peu et sont assez banaux) et
concentrons-nous sur le motif légitimant une telle mise au ban : sa
« barbe particulièrement imposante » qui traduirait non
seulement son appartenance religieuse mais encore un acte de prosélytisme
vis-à-vis des usagers et des personnels. Certes, la Caa a rappelé dans son arrêt non seulement que la liberté de
conscience et la laïcité sont deux principes constitutionnels à concilier mais
surtout – ce qui est paradoxal – qu’a
priori « le port d’une
barbe, même longue, ne saurait à lui seul constituer un signe d’appartenance
religieuse ». Pourtant, elle n’en a pas tiré les mêmes
conséquences que nous (ou alors elle s’exprime fort mal et ne donne pas les
éléments permettant de la suivre). En effet, qu’un agent public ou assimilé
(comme un stagiaire) se doive de ne pas faire état de convictions religieuses
est évident et non contesté : le principe de neutralité et / ou de laïcité
s’y oppose. Si l’intéressé psalmodiait, s’il faisait des signes de croix, s’il
donnait l’absolution à des patients, s’il récitait le Coran ou la Torah, il
était parfaitement loisible à l’administration de sanctionner un tel
comportement. Il en serait de même s’il officiait en soutane, avec une cornette
dite « à la Rolande » ou pour une femme avec un voile
islamique car ces tenues vestimentaires sont effectivement des signes destinés
à marquer une appartenance religieuse. En revanche, il n’en est rien du seul
port d’une barbe qui – même s’il est perçu comme tel et même si au fond il est
pratiqué pour une raison religieuse – ne peut et ne doit, en France en 2020
alors que l’ordre moral n’est plus, justifier une telle sanction. Peu importe
selon nous que d’aucuns aient perçu ladite formation pileuse comme religieuse
car la barbe n’est ni un comportement, ni un message, ni un vêtement :
elle fait partie intégrante de son porteur à l’instar de ses pieds, de ses
mains ou de ses yeux. Un homme qui ne rase pas ou peu a par définition de la
barbe : c’est un signe de masculinité passée la puberté et que certaines
religions l’encouragent ou non n’y change rien. Il nous paraît conséquemment
affolant qu’un juge[63] ose
justifier une sanction pour ce seul motif. Ce n’est pas la barbe qui doit
justifier une réaction mais le comportement de son porteur et si ce dernier se
contente de ne pas être rasé, personne ne devrait pouvoir le lui reprocher. Or,
précise la Cour, « dans ces conditions, il doit être regardé comme
ayant manqué à ses obligations (…), alors même que le port de sa barbe
ne s’est accompagné d’aucun acte de prosélytisme ni d’observations des usagers
du service » ! Heureusement, entre la première écriture du
présent article et sa publication, fut jugé et publié un pourvoi en cassation.
Il résulte de ce dernier que par un arrêt[64] en
date du 12 février 2020, le Palais royal a enfin affirmé solennellement que, quelle
que soit sa taille, une barbe ne peut « être regardée comme étant par
elle-même un signe d’appartenance religieuse » conséquemment contraire
au principe de Laïcité. Il en était ainsi dans l’espèce litigieuse et les juges
du fond avaient donc eu tord d’accepter la rupture unilatérale du stage du
requérant barbu hors de « circonstance susceptible d’établir [qu’il]
aurait manifesté [des] convictions [religieuses] dans l’exercice
de ses fonctions ».
Tenue correcte exigée. En définitive, on retrouve
ici avec les Tbm la fameuse
expression plus moraliste que juridique de « tenue correcte exigée »
ou pour reprendre la jurisprudence d’apparence « correcte et soignée ».
Une négligence vestimentaire ou pileuse ne justifiera jamais en tant que telle
une sanction mais s’il existe un uniforme ou des indications (par exemple dans
un règlement intérieur) d’apparence physique à respecter, leur non-respect ne
pourra être considéré comme discriminatoire[65]. De
même, on s’attendra à ce que la décence et la pudeur soient respectées ce qui
implique qu’un message érotique ou sexué que formerait un tatouage ou une coupe
de poils ou de cheveux particulière serait susceptible d’entraîner une sanction
professionnelle s’il est estimé qu’un préjudice ou un trouble est causé aux
collègues ou à la clientèle (et ainsi qu’il en fut considéré à propos d’une
employée portant des vêtements transparents et ce, sans… sous-vêtements[66]).
Concrètement, cependant, redisons-le le seul port d’une barbe ou de cheveux
longs (hors hypothèse militaire précitée) ne peut ni ne doit justifier un
licenciement a contrario de ce qu’a jugé la Caa de Versailles en 2017[67] mais
a pari de ce qu’entend la jurisprudence judiciaire de la Ca de Versailles[68]. Il
en va différemment de l’entretien. En ce sens, rappelle la même Cour, « un
soignant mal rasé » ne participeraitpas à « l’image de
la plus grande propreté corporelle requise par le règlement d’un Ehpad »
rapporte l’Annexe IV[69] de
la décision-cadre préc. 2019-2015.
Du symbolique à l’esthétique. En conclusion, on aimerait
partager le constat qu’émet Eric Guillon
dans plusieurs des livres (préc.) qu’il a écrit ou co-écrit sur le
sujet. Selon lui, en effet, alors que le tatouage a originellement été (y
compris dans les fonctions publiques ajoutons-nous) un marqueur symbolique, un
rite de passage ou d’escales parfois comme chez les marins et les légionnaires,
il semble davantage devenu une unique préoccupation d’apparence physique esthétique.
Alors que barbes et tatouages dissimulaient (en les sublimant) autrefois
les corps et gueules cassés des agents publics d’autorité, ils sont devenus
désormais des matérialisations bien moins symboliques et beaucoup plus
cosmétiques.
* Le présent article est dédié à Jordan C. des Curiosités J. pour qu’il retrouve le sourire.
[1] On entendra par tatouage la définition qu’en retient
le Snat (cf. en
ligne : https://www.s-n-a-t.org/download/charte_snat.pdf). Quant aux
attributs pileux, on les qualifiera infra au moyen du Dictionnaire
des connaissances générales utiles à la gendarmerie.
[2] Si les premiers concernent essentiellement les agents
de sexe masculin (et l’on mettra de côté l’hypothèse – dont on conviendra
qu’elle est plutôt rare en fonctions publiques – des « femmes à
barbe »), les tatouages concernent en revanche les travailleurs de tout
sexe.
[3] L’interrogation des normes, de la doctrine et de la
jurisprudence administrative sur les Tbm
en droit public est a priori décevante surtout lorsqu’après l’espoir de
considérer 453 décisions traitant de « moustaches », on réalise
qu’elles sont toutes ou presque dues à la présence en juridiction du président
Roland Moustache.
[4] Rappelons que le terme s’emploie toujours au singulier pour un être humain et au pluriel pour les poils longs d’un animal comme le chat. On dira ainsi de Mme R. E. M. qu’elle a de « la » moustache et de Chaconne de Bach qu’elle a « des » moustaches. Enfin, le plus belle des moustaches est évidemment celle du désormais célèbre « Monsieur Moustache » (Hugo S.) à qui les présents propos sont offerts.
[5] A nos yeux (dont on concédera qu’ils sont subjectifs), le plus bel article sur la question est celui de : Schmitz Julia, « Costume, vêtement(s) & droit du travail : la liberté de se vêtir au travail » in Chansons & costumes « à la mode » juridique & française ; Le Mans, L’Epitoge ; 2015 ; p. 107 et s.
[6] Cass., Soc., 28 mai 2003, n°02-40.273 dans l’affaire
désormais célèbre dite du « bermuda ».
[7] Cedh, 1er
juillet 2014 (GC), S. A. S c/ France, n° 43835/11.
[8] Cedh, 27
août 2015, Parillo c/ Italie,
n° 46470/11.
[9] Tel qu’exprimé dans la Constitution, dans la devise de
l’Etat ou encore par CE, Ass., 28 mai 1954, Barel
(Rec. p. 308).
[10] Conseil Constitutionnel, Décision n° 87-232-DC du 7
janvier 1988.
[11] Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux
conditions d’âge dans la fonction publique et instituant un nouveau Parcours
d’Accès aux Carrières de la fonction publique Territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat.
[12] Et ce, à titre très personnel, même si le sens de cette
expression nous hérisse le poil (de la barbe évidemment) ainsi qu’on l’a
expliqué in Dictionnaire de droit public interne ; Paris,
LexisNexis ; 2017 ; p. 132 et s.
[13] Loi dite Le
Pors n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
[14] Voyez en ce sens sur le site de l’institution :
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=18851.
[15] Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique et notre commentaire (critique) :
http://unitedudroit.org/FP/TFP1-MTD.pdf en partie
publié in Droit social ; 2020 ; n°03 ; p. 232 et s.
[16] Il en sera ainsi des vêtements ignifugés des pompiers
ou des treillis de camouflage des militaires.
[17] A ce propos, on se permettra de renvoyer à : Touzeil-Divina
Mathieu, « Uniformes (civils) des fonctions publiques nationales :
entre ordre(s) & Egalité » in Chansons & costumes … ; op.
cit. ; p. 161 et s.
[18] En droit privé (car nous n’avons pas – encore – trouvé
d’exemple en droit public) il en a ainsi été jugé à propos d’un agent de
sécurité à qui l’on imposait, à tort, un uniforme alors qu’il était enfermé
dans une cabine de visionnage de télésurveillance sans contact avec le public.
[19] Ainsi est confirmé le licenciement de l’agent de
police portant un foulard visible sous sa casquette réglementaire ainsi que des
vêtements longs dissimulant ses bras sous un polo à manches courtes : Caa Paris, 19 février 2019
(n°17PA00273).
[20] Il en va ainsi de la compagnie de service (encore)
public Air France.
[21] Reproduite au Journal militaire ; 1832 ;
p. 182 et s.
[22] Cette dernière étant, selon le Dictionnaire préc.
des connaissances générales utiles à la gendarmerie (Paris,
Lavauzelle ; 14e éd. de 1902 ; p. 523), la « partie
de la barbe qui pousse au-dessus de la lèvre supérieure ». La barbe se
définissant quant à elle comme l’« ensemble des poils qui poussent sur
le visage de l’homme (sic) » (ibidem ; p. 94 et s.). V.
également : Dupuis Delphine, Petit
manuel de la moustache et de la barbe ; Paris, Les vieux tiroirs ;
2013 ; spécialement p. 158 et s.
[23] Il s’agissait – encore – de Nicolas Joseph Maison (1771-1840) entre temps devenu
Ministre de la Guerre.
[24] In Gend’Info ; juillet 2011 ;
repris in Libération du 15 juillet 2011.
[25] Art. 331 du décret du 21 septembre 1916 sur le service
intérieur des corps de troupe in Bulletin des Lois de la République
française ; 1916 ; p. 1559.
[26] Cf. Décret du 1er avril 1933 portant
règlement du service dans l’armée. 1re partie. Discipline générale. Mis à jour
à la date du 15 avril 1940 ; Paris, Lavauzelle ; 1940 ; p.
33.
[27] Touzeil-Divina Mathieu & Touzeil Tiphaine, « Un droit à
l’utopie ? Voyage au cœur des aventures du Philémon de Fred » in Le Droit dans les Bandes dessinées ;
Paris, Lgdj ; 2012 ;
p. 171 et s.
[28] On reprend ici des éléments développés in « Uniformes
(civils) des fonctions publiques nationales » préc.
[29] On lira à cet égard les deux premiers chapitres (à
propos de la Bible, de l’Islam et du poil) de : Auzépy Marie-France & Cornette
Joël (dir.), Histoire du poil ; Paris, Belin ; 2011.
[30] Perruques qui furent cependant abandonnées en France
sur prescription… et pression médicale ainsi que le rappelle : Herzog-Evans Martine, « To robe or
not to robe : discussion internationale informelle autour du port de la
robe par les magistrats et les avocats » in Ajdp ; juillet
2013 ; n°7, p. 395 et s. Ces mêmes perruques, d’ailleurs, furent
importées depuis la mode française au Royaume-Uni où elles sont demeurées,
notamment dans le costume juridique, encore d’actualité : Woodcock Thomas, Legal habits ; a brief sartorial history of Wig, Robe and Gown ;
Londres, Ede and Ravenscroft ; 2003.
[31] Affaire notamment racontée par Rousselet Marcel, Histoire
de la magistrature française ; des origines à nos jours ; Paris,
Plon ; 1957 ; Tome I ; p. 347 et s.
[32] Cf. Deligand Edouard, Les gens de robe peuvent-ils porter moustache ?; Sens,
Duchemin ; 1876.
[33] Cité par M. Julien ;
op. cit. ; p. 06.
[34] Dupuis
Delphine, Petit manuel de la moustache et
de la barbe ; Paris, Les Vieux tiroirs ; 2013 ; p. 161.
[35] A son sujet : Cronier
Emmanuelle, « Les poilus » in Histoire du poil ; op. cit. ;
p. 235 et s.
[36] Au présent ouvrage on lira avec profit : Dhalluin Sébastien, « Marquer les
hommes comme l’on marque les bêtes : la peine de la flétrissure, une
altération judiciaire des corps criminels » ; p.63 et s.
[37] Il s’agit du XIe « baromètre »
de la perception des discriminations dans l’emploi (2018), accessible
sur :
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/etudresult-harcmoral-a4-num-30.08.18.pdf.
[38] Ibidem ; p. 03 du « baromètre ».
[39] Duflos
Julie & Hidri Neys Oumaya, « Entre perceptions
accrues et recours marginaux : le paradoxe des discriminations selon
l’apparence physique à l’embauche » in Les cahiers de la LCD ;2018 ; n°6 ; p. 99 et s.
[40] Https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-paris/documents/publication/wcms_452486.pdf.
[41] Que décrypte (outre son histoire et ses évolutions) le
catalogue de l’exposition (du Musée du Quai Branly) Tatoueurs, tatoués ;
Paris, Actes Sud ; 2014. Peuvent également être consultés à ce sujet non
seulement plusieurs des articles du site Internet du Syndicat National des
Artistes Tatoueurs et des professionnels du tatouage (Snat)
(https://syndicat-national-des-artistes-tatoueurs.assoconnect.com/page/86330-accueil)
ainsi que : Le Breton David, Signes
d’identité ; tatouages, piercings et autres marques corporelles ;
Paris, Métailié ; 2002.
[42] Ainsi qu’en témoignent les très beaux livres de :
Pierrat Jérôme & Guillon Eric, Les vrais, les durs,
les tatoués : le tatouage à Biribi ; Paris, Larivière ; 2005
et (des mêmes auteurs) Mauvais garçons, tattoed underworld a portrait
gallery ; Paris, Manufacture de livres ; 2013.
[43]
Https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/girardin/Rapport_LHorty_final.pdf.
[44] Dont l’Unsa-Police
qui le rappelle avec fierté :
http://police.unsa.org/specialistes/conditions-de-travail/article/tatouages-barbes-et-moustaches-l-unsa-police-obtient-satisfaction.
[45] In Bomi (Bulletin
Officiel du Ministère de l’Intérieur) ; 2018-02 ; p. 196 et s.
[46] Ces deux exemples – non fictifs – ayant été confirmés
par plusieurs agents (dont un « grand barbu ») et anciennement
manceaux que l’auteur du présent texte tient à saluer et à remercier. Pour le
cas du masque à gaz, la jurisprudence confirme a priori l’analogie avec
un agent administratif qui refusait de se raser impliquant qu’il ne pouvait
plus porter l’appareil de protection respiratoire que son emploi d’entretien de
la piscine municipale imposait : Caa
de Versailles, 19 février 2008 (n°06VE02005).
[47] Sur le sujet : Pierrat
Jérôme & Guillon Eric, Les
gars de la marine : le tatouage de marin ; Paris,
Larivière ; 2005. Les auteurs rappellent notamment que c’est à la Marine
que l’on doit même le mot « tattow » transformation du « tatau »
tahitien des marques dermiques bleutées.
[48] Pierrat
Jérôme & Guillon Eric, Marins
tatoués (…); Paris, Manufacture de livres ; 2018.
[49] Cf. « à
propos du port de l’uniforme (prison) » in
Ajfp ; juillet
2004 ; n°4, p. 204 et s.
[50] C’est la célèbre jurisprudence de l’agent immobilier
en jogging (Cass., Soc., 06 novembre 2001, Brunet ;
Liaisons sociales ; 20 décembre 2001 ; n°746) ou du
salarié en bermuda (Cass., Soc., 28 mai 2003 (02-40273)).
[51] Https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/decision-cadre_apparence_physique.pdf.
[52] Glasson
Ernest-Désiré, Les origines du costume de
la magistrature, Paris, Larose et Forcel, 1884 ; p. 17.
[53] Dans sa version actualisée en 2012, il est encore en
ligne ici :
http://www.fpip-police.fr/wp-content/uploads/2012/03/RIPN.pdf.
[54] Voyez en ce sens à l’occurrence « M comme
Moustaches » in Touzeil-Divina
Mathieu & Boninchi Marc, « Dictionnaire policé du Droit de
l’opéra au XIXe siècle » in
Droit & Opéra ; Paris, Lgdj ;
2008 ; p. 338 et s.
[55] Cité par Baillette
Frédéric, « Organisations pileuses et positions politiques ; à
propos de démêlés idéologico-capillaires » in Quasimodo ; n°7 ; Montpellier ; 2003 ; p. 121
et s.
[56] Le Senne Charles, Code du théâtre (…) ; Paris, Tresse ; 1878.
[57] Ce qui semble pourtant incompatible avec la sécurité
des agents (le poil étant particulièrement inflammable) mais est attesté dans
plusieurs documents dont le truculent Carnet de la Sabretache : revue
militaire rétrospective ; publiée mensuellement par la Société « La
Sabretache » ; Paris, Leroy ; 1937 ; p. 525.
[58] Cochet de Savigny
Pierre Claude Melchior, de la gendarmerie (…) ; Théorie
militaire et administrative ; Paris, Léautey ; 1844 ; Tome
II ; p. 879 et s.
[59]
Https://www.lepoint.fr/societe/les-crs-ouvrent-la-chasse-aux-barbus-03-03-2017-2109169_23.php.
[60] Sur ce sujet, on lira au présent ouvrage : Nicaud Baptiste, « Tatouage et liberté d’expression » ; (…)
[61] CE, 04 juillet 2018, B. (req. 419180).
[62] (15VE03582) commenté par nos soins au Jcp A 2018 ; n°02 ; 14 et
s.(dont les propos suivants sont tirés).
[63] Encouragé, cela dit, par les propos de plusieurs
politiques jusqu’au sommet de l’Etat. On se souvient en ce sens des
déclarations hallucinantes du ministre de l’Intérieur, Castaner, en octobre 2019 expliquant (devant plusieurs
commissions parlementaires à l’Assemblée Nationale comme au Sénat) que, parmi
les signes de radicalisation des islamistes, il fallait être particulièrement
sensible à la barbe. Ces mots ont provoqué le dégoût puis l’hilarité de
nombreux citoyens qui les ont dénoncés et raillés sur les réseaux sociaux, au
moyen du hashtag #SignaleUnMusulman, dénonçant à ce titre plusieurs dangereux
barbus comme le premier ministre Edouard Philippe,
l’ancien président du parti des Républicains, Laurent Wauquiez ainsi que de nombreux hipsters !
[64] Avec nos observations « Au nez et à la barbe des
juges du fond, le Conseil d’Etat rappelle (enfin) qu’en soi porter la barbe
n’est ni illégal ni contraire au principe de Laïcité » in Jcp A n°08 ; 2020 ; p. 03
et s.
[65] CA Nancy, 06 février 2013 (n° 12/00984) cité dans la
décision-cadre préc. du Défenseur des droits.
[66] Cass., Soc., 22 juillet 1986 (n°82-43.824) in
Liaisons sociales n°5844 ; p. 07.
[67] Et a priori aussi à la mairie de
Tremblay-en-France en 2011 où un fonctionnaire semble avoir connu le même sort
selon : Feixas Jean & Pierrat Emmanuel, Barbes et
moustaches ; Paris, Hoëbeke ; 2015 ; p. 98.
[68] A propos d’un salarié de supermarché respectant le
port des vêtements de la « marque » au service de laquelle il était
employé mais à la barbe et aux cheveux longs (ainsi qu’avec une boucle
d’oreille) ce qui n’a pas été jugé contraire à la « tenue propre et
correcte » imposée par le règlement intérieur de l’enseigne : Ca de Versailles, 08 juillet 1994,
n°93-6638.
[69] Op. cit. ; p. 33 à propos de CA
Versailles, 31 août 2011, n°10/03526.
Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).